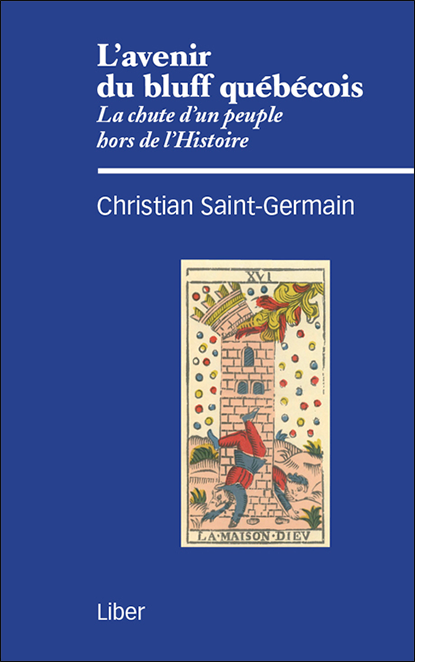October 20, 2015
L’avenir du bluff québécois
Christian Saint-Germain
2015
La chute d’un peuple hors de l’Histoire
« Ce livre est un livre de colère, dont on sait qu’elle est d’habitude mauvaise conseillère. Il y a pourtant des vérités qui resteraient non dites si cette passion ne leur ouvrait pas la voie. Plus encore que la colère, c’est peut-être la lassitude qui en est l’origine, ou plutôt l’exaspération. Le spectacle de marionnettes politiques d’ordinaire pitoyables connaît depuis quelques années des sommets dans l’ordre de la vénalité. Le peuple croit assister à une joute constitutionnelle depuis les années 1960, il participe à son enfermement biocratique, à un délire assurantiel socialement orchestré.
L’indépendance du Québec, le peuple n’a jamais été capable ni de la concevoir ni moins encore de la vouloir au-delà de la simple agitation tribale contenue dès les années 1970 par la camisole de force du “ modèle québécois ”. Il va sans dire qu’il ne s’est jamais agi d’un espace favorisant l’émergence de la liberté individuelle ou celui de leaders charismatiques. Au mieux, un projet de vaccination collective conduit par des valets meurtris, des comédiens fourbes ou des “ maudits bons gars ” qui n’ont jamais su ce que pouvait bien signifier le prix d’une entrée dans l’Histoire. » C. S.-G.
***
Qui mâche ses mots avale sa langue: rencontre avec CHRISTIAN SAINT-GERMAIN
RALPH ELAWANI, Spirale, 19 octobre 2015
Avec la récente parution, aux éditions Liber, du brûlot L’avenir du bluff québécois, la prose napalmisante du philosophe CHRISTIAN SAINT-GERMAIN sert de véhicule à une interrogation sur l’usage véritable de l’illusion nationaliste. À travers les 86 pages composant ce « livre de colère », l’auteur s’attaque à ce qu’il considère « un projet de vaccination collective conduit par des valets meurtris, des comédiens fourbes ou des ‘‘maudits bons gars’’ qui n’ont jamais su ce que pouvait bien signifier le prix d’une entrée dans l’Histoire » (p.13).
Pirouettes identitaires, convivialité hypocrite et autres esbroufes ne sont au final, pour SAINT-GERMAIN, qu’un signe de la perte de vue d’un projet n’ayant jamais été au cœur des préoccupations des partis souverainistes.
Spirale s’est entretenu avec CHRISTIAN SAINT-GERMAIN afin de faire lumière sur cet ouvrage que l’auteur a pris le soin de dédier à la mémoire de PIERRE VALLIÈRES.
RALPH ELAWANI : Selon vous, notre prétendue « dissolution » dans le Canada est-elle celle de notre signifiance ou de notre insignifiance?
CHRISTIAN SAINT-GERMAIN : Bon, d’abord, la « dissolution ». Huit millions, ça ne disparaît pas comme ça. Mais ça disparaît de la manière la plus honteuse, c’est-à-dire, avec des supplications pour qu’on garde un peu de français, qu’on garde des apparences de ce qu’on est. C’est pour ça que la métaphore de l’euthanasie et des soins de fin de vie est si importante [dans L’avenir du bluff québécois]. C’est une métaphore collective qui ne veut dire que ceci : on sait qu’on va mourir collectivement, on n’a jamais voulu se battre pour vivre, on veut juste disparaître sans douleur, sans souffrance, sans même avoir à trop y penser. C’est ça qu’on demande des chefs politiques. On est prêt à s’engueuler un peu sur l’indépendance, mais ça ne dépassera jamais la simple esbroufe, le simple petit coup de gueule ponctuel. Tout le rapport à notre histoire et à notre précarité ethnique est disparu avec notre anglicisation progressive. Dans le fond, on est mort à peu près en 1995, mais on ne s’en est pas encore aperçu. C’est ça qu’on doit se dire. Au référendum de 1995, on est collectivement décédé, en politique. On est devenu un cheptel avec une vie animale désorganisée et sans symbolique. On est mort là. On n’a pas encore reçu la nouvelle par la poste. Mais on le sait dans notre inconscient collectif. On met beaucoup d’énergie à essayer de ne pas s’en apercevoir, un peu comme dans le refoulement névrotique. C’est pour ça que le « procès » de Bouchard et Parizeau était si urgent. Ce sont des hommes qui ont contribué à notre disparition, involontairement, sans doute. Choisis par des colonisés, ce sont des hypercolonisés, mais des bons perdants, des perdants sympathiques, des perdants gentils, auxquels on s’identifiait, mais en tant que perdants.
Dans sa correspondance, le poète Claude Gauvreau discute avec un dénommé Dussault, un chroniqueur qui a longtemps travaillé à La Presse, et lui dit : « il n’y a rien comme du monde servile pour se reconnaître dans d’autre monde servile, et, à l’inverse aussi, pour reconnaître les gens qui seraient véritablement dangereux ». Ce que j’essaie de dire là, c’est que Bouchard et Parizeau n’ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis selon la logique de la certitude qu’avec eux, il n’arriverait rien d’important. Et pourtant, ce sont les deux plus grands Premiers ministres de l’histoire moderne. On s’entend là-dessus, c’est pas …
ELAWANI : André Boisclair ou Pauline Marois?
SAINT-GERMAIN : Non, c’est pas Boisclair ou Pauline Marois ou bien Pierre-Karl Péladeau. Avec ceux-là, on est dans les rejetons les plus risibles du Parti québécois qui est en train de mourir tranquillement avec ses fonctionnaires de la Régie du logement et son fonctionnement bureaucratique de ronds de cuir. Dans le fond, on voudrait élire le Dalaï-Lama, mais on élit du monde avec qui l’on sait que ça va tourner au ridicule. Je veux dire, ça va tourner ainsi : au lieu d’un pays, on va avoir une équipe de hockey. On va réaliser la prophétie de Sam Hamad [« Les gens de Québec veulent une équipe de hockey, pas un pays »].
ELAWANI : Vous écrivez : « […] C’est le statut pathologique de l’hospitalité québécoise : les immigrants nous regardent de haut ou pas du tout, comme c’est le cas à Outremont. Ils n’ont pas tort » (p. 40). En 1994, Pierre Foglia écrivait, comme nous le rapporte le récent livre de Marc-François Bernier, Foglia l’insolent, que « c’est dans l’imaginaire des étrangers qu’il [le Canada] existe le plus » (Bernier, p. 60). Partagez-vous cette impression?
SAINT-GERMAIN : Oui, sûrement. En fait, la seule formulation qui explique le petit passage sur lequel vous mettez de l’emphase tient du fait que le problème des Québécois, pour être une véritable société hospitalière, est que leur propre identité n’est pas solide. Elle n’est pas ancrée, de sorte que c’est une hospitalité pathologique, pas une « vraie » hospitalité. Elle ne serait vraie, elle serait non « raciste », justement dans la mesure où elle serait posée. Comme elle n’est pas posée, pour des raisons politiques sur lesquelles j’élabore beaucoup dans l’ouvrage, c’est normal que le rapport soit assez ambigu et que leur hospitalité soit trompeuse, disons. Ou pas véritable. Ils ne sont pas assez assis eux-mêmes, entre guillemets, sur leur identité pour pouvoir accueillir qui que ce soit, ne s’étant pas accueillis eux-mêmes dans un processus politique d’autoaffirmation. S’étant refusés eux-mêmes, ils sont mal venus d’accueillir les autres. Se croyant déjà sur un territoire et croyant le posséder et l’habiter, ils restent, à mon sens, colonisés. Ça rend l’accueil ou l’hospitalité problématique. Dans le fond, ils n’ont même pas la capacité d’être racistes, si j’ose dire. Je ne leur reconnais pas la capacité de l’être, car ils ne peuvent même pas servir la fonction d’être un « groupe ethnique ».
ELAWANI : Vous dénoncez ce qu’on pourrait qualifier d’un véritable « gavage utérin » visant à accoucher d’une souris. Vous écrivez : « […] ressentez-vous votre disparition progressive dans le grand tout multiculturel canadien comme un drame constitutionnel au point de vouloir en sortir? Pas pantoute, je roule avec deux chars! » (p. 41).
SAINT-GERMAIN : C’est que dans le fond, on a fait d’une question existentielle – la question nationale – une question de revendications économiques, d’accession à la propriété et toutes ces sornettes, plutôt que de passer par la question de notre survivance, comme « survivalistes ethniques », si j’ose dire. Plutôt que de tabler sur la survivance, on a tablé sur le fait que ce serait bien mieux d’être « autrement »… et moi, c’est à cet « autrement »-là que je ne crois pas. Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’avantages économiques à faire l’indépendance – il y a toujours un avantage à s’occuper de ses propres affaires – mais ce n’est pas par là qu’il fallait passer. Il fallait passer par la question collective et par la « promesse », comme dans le texte de Walter Benjamin que je cite, que nous étions supposés tenir par rapport aux ancêtres qui, il y a 400 ans, sont arrivés ici et ont essayé d’organiser, dans une folie catholique, l’Amérique Française. La revendication nationaliste est extrêmement anémique et pauvre. Elle ne se branche pas sur la machine symbolique qui l’a fondée à l’origine; elle s’est coupée de ça durant la Révolution tranquille. Elle l’a niée, a tenté de s’en départir et l’a saccagée. Là, elle ne se retrouve avec aucun projet, aucun lien organique à l’histoire. On dit juste « vous n’aurez pas de dédoublements administratifs si vous adoptez le Québec des nationalistes ». C’est du niaisage bureaucratique.
ELAWANI : C’est safe…
SAINT-GERMAIN : Non, c’est pas safe dans la mesure où ça ne réussit pas ce que ça prétend vouloir faire. Ça anéantit un autre modèle qui serait de dire : « nous, on ne fait pas l’indépendance pour des raisons économiques ».
ELAWANI : Il n’y a pas de révolution qui va précéder une révolution culturelle, en ce sens.
SAINT-GERMAIN : Exactement. C’est ça.
ELAWANI : Je vais encore ramener Foglia, car tout ça me fait penser à sa citation : « J’ai commencé par être indépendantiste marxiste. L’indépendance du Québec était un épisode de la révolution socialiste. L’indépendance serait une belle et grande chose pour la classe ouvrière, disais-je. Lorsque le PQ a pris le pouvoir, j’ai bien vu que l’indépendance était surtout une belle et grande chose pour le Mouvement Desjardins » (Bernier, p. 53)
SAINT-GERMAIN : Il faudrait ajouter Vidéotron! C’est pour ça que le livre s’ouvre sur la formule de Mao Tsé-Toung : « La lutte nationale est, en dernière analyse, une lutte de classe ». Ce n’est pas parce que je suis amoureux de Mao Tsé-Toung, c’est parce que tout le livre est une variation, au sens musical, sur cet exergue. Et dans le fond, les personnages de Parizeau et de Bouchard ont bien montré ça. Ce que j’appelle le « rat des villes » et le « rat des campagnes ». Un ancien riche et un nouveau riche qui ne marchent qu’en terme d’argent, jamais en terme symbolique, toujours dans la négociation, toujours au marché aux puces : « on va vous avoir les pneus au meilleur prix, ‘z’allez voir, y roulent b’en, vos pneus ». C’est pathétique quand on y pense.
Il y a une question sur laquelle je n’ai pas pu travailler, c’est cette anomalie, c’est le fait que c’est ce que j’appelle « l’anomalie biodémocratique », c’est-à-dire : comment un peuple qui est aussi développé au niveau bureaucratique, qui a ses tribunaux, ses universités, ses caisses de dépôt, décide de ne pas utiliser ses jambes pour marcher. C’est quand même troublant. Mais c’est tout le mystère de l’état de colonisé, bien sûr, dans ses ambivalences et ses contradictions. Me semble qu’il aurait fallu travailler plus pour expliquer ça. Ce sera mon prochain travail : comment comprendre cette inhibition-là à exister?
ELAWANI : Et côté culturel, si l’idée nous venait de « faire un pays », qu’est-ce qu’il nous reste, si l’on écarte le pôle économique?
SAINT-GERMAIN : Au moins la persistance d’une langue extrêmement riche et extrêmement complexe qui nous dépasse. C’est ça qui nous reste. Ça et l’idée que du monde a traversé l’Atlantique dans une folie extraordinaire, cette folie grandiose de l’Amérique française à laquelle on est relié… et la transmission de cette Amérique française à nos enfants. Si l’on n’a rien à transmettre et si l’on s’imagine qu’ils ne sont venus ici que pour exploiter les Amérindiens et vendre des fourrures, déjà t’as plus grand-chose à offrir et à transmettre… ce qui a été le cas dans notre transmission de l’histoire. À partir du moment où tu t’es décapité toi-même avec la Révolution tranquille…
Le livre se place en porte à faux avec la Révolution tranquille. Contrairement à ce qu’on pourrait penser spontanément, le nationalisme a été mis à mal par la Révolution tranquille. Même s’il y a eu des affirmations nationales, c’était des affirmations nationales localisées et des questions comme « nationaliser l’Hydro »… Eh bien, l’Hydro, elle ne se comporte guère mieux que Westmount Light and Power [Hydro-Westmount]; elle déconnecte les pauvres à distance maintenant, à 14% d’intérêt pour les comptes en retard, elle nous traite avec la même dureté et la même insolence que si elle était une compagnie américaine. Les soi-disant gains de la Révolution tranquille sont assez minces quand on les regarde. Il y a toute une mythologie à l’égard de la « grande noirceur » – oui, certainement, ce n’était pas le lieu des libertés -, mais là, il faut garder un sens historique à ce qui se passait. Le fait qu’une cohorte démographique a pris le pouvoir n’a pas donné ce que la cohorte prétend qu’elle a donné… elle n’a rien donné parce qu’elle venait directement des noirceurs. D’où tenait-elle sa soi-disant capacité d’élucidation et d’émancipation? Elle la tenait du cours classique, qu’elle n’a pas voulu transmettre par la suite aux étudiants lors de la massification scolaire parce qu’elle était trop paresseuse pour travailler par rapport à son propre héritage. Ils n’ont pas voulu transmettre ça. Mais s’ils ont été capables de le faire [le cours classique], c’est qu’ils ne venaient pas de la planète Mars… C’est parce que cette noirceur n’était pas si terrible. Quand tu entends Guy Rocher et tous ces barbons qui viennent nous raconter comment c’était noir, comment c’était dur… c’est gravement exagéré. Ça a surtout l’inconvénient de nous placer en porte à faux par rapport à notre propre origine.
ELAWANI : Il est à la fois étonnant et pas étonnant du tout que votre livre, paru le 24 août dernier, ne suscite pas des débats, ne soit pas discuté sur les ondes de talkshows ou à la radio. Par exemple, dans un contexte différent, ce genre de livre, en France, aurait suscité de vives réactions.
SAINT-GERMAIN : Ça commence… mais on me cale dans la foulée d’autres livres qui viennent de paraître, par exemple [Éric] Bédard qui vient de faire paraître un livre sur son rapport avec Jacques Parizeau, Lisée va sortir son affaire pour essayer de se défendre. Le sociologue [Jacques] Beauchemin, de l’UQAM, a sorti quelque chose sur la souveraineté, etc. Je suis dilué là-dedans. Les médias ne se cassent pas la tête.
ELAWANI : Selon vous, qui aurait pu être de taille à faire l’indépendance? Est-ce simplement une question d’entourage politique?
SAINT-GERMAIN : Il y a certainement une question d’entourage. On serait plus rassurés de voir des leaders nationalistes entourés de retraités de la police et d’anciens membres des forces militaires canadiennes, mais pro-Québécois. Au moins pour l’intégrité du territoire et la sécurité des institutions. On n’a jamais conçu le projet… c’est pour ça que je dis que ce n’est pas un projet, en fait, c’est un symptôme névrotique. Dans le fond, on n’a jamais conçu le projet en se disant « si ça marche, on va devoir faire un minimum de choses. On était pâmé devant le fait que Parizeau avait pensé à l’effondrement et on s’imaginait que c’était le summum de la finesse stratégique.
ELAWANI : Ne trouvez-vous pas que Péladeau incarne justement ce genre de symbole? « J’en ai de l’argent, au cas… »
SAINT-GERMAIN : C’est justement pas d’argent dont on a besoin. Le problème réside en ces populations qui seraient mécontentes. Ces populations très localisées et organisées, par exemple, dans l’Ouest-De-L’Île, on pourrait dire « la question n’était pas claire », etc. Là, avec la loi de [Stéphane] Dion, c’est une question de droit interne au Canada. La démocratie, ça marche tant qu’on ne cherche pas à la remplacer par autre chose. C’est-à-dire : que l’on n’ait jamais calculé la possibilité de violence, que la violence ne soit jamais apparue plausible – pas parce qu’on la souhaite… mais dans le fond, le fait qu’il n’y ait pas de préparation de cette nature-là, c’est ça qui est consternant. C’est ce qui me fait dire que le projet n’est pas un projet et qu’on ne doit pas le prendre au sérieux. On serait mieux de construire des ambassades pour les ovnis. On aurait plus de chance de voir des ambassades pour les extraterrestres qui fonctionnent que de voir ce projet-là qui se résume à quelque chose que l’on ne veut pas. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait faire ça? Je ne sais pas. Ça prendrait une figure archaïque du chef, une figure qu’on ne peut pas s’empêcher de concevoir. Quelqu’un qui est résolu. Ce qu’on n’a pas.
***
Entrevue avec JEAN-FRANÇOIS AUBÉ, auteur des ‘yeux de la Nation’ (2014) (April 7, 2014)